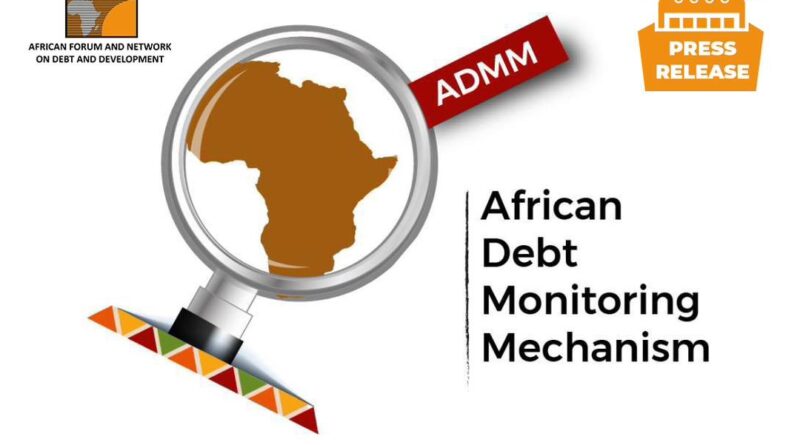L’Afrique se dote d’un mécanisme inédit pour surveiller sa dette : un pas décisif vers la souveraineté financière
Alors que la crise de la dette fragilise plusieurs économies africaines, une nouvelle ère s’ouvre sur le continent. Réunis à Johannesburg, les ministres africains des Finances ont adopté le tout premier mécanisme africain de surveillance de la dette, un instrument inédit pour renforcer la transparence, la coordination et la souveraineté financière de l’Afrique.
L’Afrique franchit une étape historique dans sa gestion de la dette. Les ministres africains des Finances ont adopté la création du Mécanisme africain de surveillance de la dette (ADMM), un outil continental chargé de suivre et d’analyser la dette intérieure et extérieure des États membres en temps réel. La décision a été entérinée lors de la 8ᵉ session du Comité technique spécialisé de l’Union africaine (UA) sur les finances, la planification économique et l’intégration, tenue à Johannesburg du 29 septembre au 3 octobre 2025.
Cette rencontre, placée sous le thème « Combler le déficit de financement de la santé en Afrique dans un contexte géoéconomique en mutation », a rappelé le paradoxe africain : alors que les besoins en matière de santé publique augmentent, les budgets nationaux sont étranglés par le poids d’une dette toujours plus lourde. En 2023, les pays africains ont versé près de 85 milliards de dollars pour le service de la dette, le montant le plus élevé depuis 1998. Aujourd’hui, neuf pays sont déjà en situation de surendettement et onze autres à haut risque, selon les données du Comité.
Le nouveau mécanisme, soutenu par l’Association africaine des marchés financiers (AAMFI), découle d’une décision du Conseil exécutif de l’Union africaine en 2022. Il vise à renforcer la coordination et la transparence budgétaire à travers un système commun de collecte et d’analyse des données sur la dette publique.
« Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de l’Union africaine ont fait un pas important en approuvant la création d’un outil d’analyse de la dette en temps réel », explique le Dr Patrick Ndzana Olomo, directeur par intérim de la Commission de l’UA pour l’économie et l’industrie.
Pour Malack Luhanga, du Bureau de gestion des données sur la dette du ministère zambien des Finances, la réussite du mécanisme dépendra de sa capacité à instaurer une transparence réelle :
« L’ADMM doit garantir la clarté à chaque étape, de la stratégie à la diffusion des données et s’ancrer dans les cadres juridiques nationaux. »
Mais au-delà des considérations techniques, la création de ce mécanisme intervient dans un contexte où la dette compromet directement les dépenses sociales. Selon la CNUCED, près de la moitié des pays africains consacrent aujourd’hui plus de ressources au paiement des intérêts de la dette qu’à la santé. Une tendance inquiétante pour la commissaire de l’Union africaine chargée du développement économique, S.E. Francisca Tatchouop Belobe, qui appelle à une meilleure coordination entre ministères de la Santé et des Finances :
« Vingt ans après la Déclaration d’Abuja, les pays africains n’allouent en moyenne que 7,4 % de leurs budgets à la santé, soit la moitié de l’objectif fixé. Nous devons bâtir des systèmes résilients et équitables. »
Derrière cette avancée institutionnelle, un acteur s’est imposé comme force motrice discrète : l’AFRODAD (African Forum and Network on Debt and Development). Depuis plusieurs années, l’organisation plaide pour une réforme de la gouvernance de la dette africaine et la création d’un mécanisme continental de suivi indépendant.
Sous la direction de Jason Rosario Braganza, l’AFRODAD a mené un plaidoyer soutenu auprès des institutions panafricaines. Pour lui, la mise en place de l’ADMM consacre des années de mobilisation :
« L’ADMM s’inscrit dans l’Agenda 2063 et dans le Traité d’Abuja sur l’architecture financière africaine. C’est un pas décisif vers une restructuration cohérente et coordonnée de la dette, mais aussi vers une plus grande souveraineté financière du continent. »
L’organisation voit dans ce mécanisme une victoire collective et un tournant stratégique : il permettra de centraliser les données sur la dette à partir d’un noyau africain, au sein de la Commission de l’Union africaine, et d’offrir une lecture africaine des chiffres souvent produits par des institutions extérieures. Cette évolution devrait aussi contribuer à renforcer la crédibilité du continent face aux agences internationales de notation et aux marchés financiers.
Pour Braganza, l’ADMM s’inscrit dans un ensemble plus vaste de réformes destinées à bâtir une architecture financière africaine intégrée, aux côtés de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), du Fonds monétaire africain, de l’Institut monétaire africain et de la future Agence africaine de notation de crédit.
« Résoudre la crise de la dette, c’est investir dans la santé et dans l’avenir du continent. L’Afrique doit être un acteur, pas un simple exécutant », affirme-t-il.
Avec l’ADMM, les États africains disposent désormais d’un instrument concret pour surveiller leur dette, mieux planifier leurs budgets et investir dans les priorités sociales, de la santé à l’éducation.
Josée Baituambo